Exercice 1. 6 points
QCM 1. On considère la fonction f définie sur R par f (x) =(e
x-2) / (e
x+2).
Alors pour tout réel x, f '(x) est égale à :
On pose u = e
x-2 et v = e
x+2.
u' = v' = e
x.
(u'v-v'u) / v
2 = e
x((e
x+2)-(e
x-2)
) / (e
x+2)
2 = 4e
x /
(ex+2)2 ; réponse A.
QCM 2. La limite en +oo de A =4x-3ln(x) est égale à :
A =x ( 4 -3ln(x) / x ).
Par croissance comparée : ln(x) / x tend vers zéro si x tend vers +oo.
A tend vers +oo. Réponse A.
QCM 3 On considère la fonction f définie sur R par f (x) =
x
3 / (x
4+2).
Une primitive de f sur R est la fonction F définie pour tout réel x par :
On pose u = x
4+2 ; u' = 4x
3.
f(u) = 0,25 u' / u.
F = 0,25 ln(u) =0,25 ln(x
4+2).
Réponse B.
QCM 4
Le nombre de solutions réelles de l’équation exp(1 /x) = 1 / exp(x) est :
exp(1/x) * exp(x) = 1.
exp(1 /x +x) = 1.
1/x +x= ln(1) = 0.
1 /x = -x ;
x
2=-1. Aucune solution réelle.
Réponse C.
QCM 5 Le nombre de solutions réelles de l’équation ln (x
2)
= (ln(x))
2
est :
2 ln(x) = (ln(x))
2.
On pose X = ln(x) ;
2 X = X
2.
X
2-2X =0.
X(X-2) =0.
Solutions X = 0 et X = 2.
ln(x) =0 soit
x =1 ; ln(x) =2 soit
x = e2.
Réponse A.
QCM 6 Une promotion de 50 étudiants doit élire deux délégués. Le nombre de possibilités
est :
(
50 2)=50 * 49 / 2 = 1225.
Réponse C.
Exercice 2. 6 points.
QCM 7Le quart d’une
population a été vacciné contre une maladie contagieuse. Dans cette
population, au cours d’une épidémie de cette maladie, on constate qu’il
y a, parmi les malades,
une personne vaccinée pour quatre non vaccinées et aussi un malade sur
douze parmi les
personnes vaccinées.
Dans cette population, la probabilité de tomber malade est :
On appelle les événements :
V : la personne est vaccinée
M : la personne est malade.
Probabilité de choisir une personne vaccinée : P(V) = 0,25.
Probabilité de choisir une personne vaccinée parmi les malades : P
M(V) = 1 /5 = 0,2.
Probabilité de choisir un malade parmi les vaccinés : P
V(M) = 1 /12.
P(V n M) = P(V) x P
V(M) = 1 /4 x 1/12 = 1 /48.
P
M(V) = P(V n M) / P(M) =1 /5 .
P(M) =5 P(V n M) = 5 /48.
Réponse B.
QCM 8À l’épreuve de
mathématiques du concours d’entrée à l’Ecole de Santé des Armées, les
candidats sont sélectionnés en répondant à 10 questions.
Pour chaque question, ils doivent choisir la bonne réponse parmi quatre
affirmations dont
une seule est exacte.
Un candidat se présente et répond à toutes les questions au hasard. La
probabilité qu’il ait
au moins 9 réponses exactes est égale à :
On note X la variable aléatoire donnant le nombre de bonnes réponses
aux 10 questions. X suit la loi binomiale de paramètres n = 10 et p = 1
/4.
P(X
>9) = P(X=9 )+ P(X) =10.
P(X=9) = (
10 9) * 0,25
9 *0,75
1=10 *0,25
9 *3 /4= 30 /4
10.
P(X=10) = (10 10) * 0,2510 *0,750=1 *0,2510 *1= 1 /410.
P(X >9)=(30 +1)/ 410. Réponse C.
QCM 9. Si une fonction f définie sur R vérifie : x+2
< f (x) pour tout réel x, alors on peut déterminer
la limite de la fonction f lorsque x tend vers :
La limite de x+2 quand x tens vers +oo est +oo.
Si x+2
< f(x) d'après les théorèmes de comparaison f(x) tend vers +oo si x tend vers +oo.
Réponse D.
QCM 10
On considère une suite réelle (u
n) strictement croissante de premier terme u
0 = 1.
La suite (v
n) est définie pour tout entier naturel n par v
n =
−1
/ (1+3u
n)
.
Alors la suite (v
n) est :
v
n+1-v
n=
−1
/ (1+3un+1) +1
/ (1+3un)=(-1-3un+1+3un+1) / ((1+3un+1)(1+3un))=3(un+1-un) / ((1+3un+1)(1+3un)).
La suite (un) étant strictement croissante : un+1-un > 0.
De plus u0 = 1 >0 et la suite (un) est croissante : tous les termes de (un) sont supérieurs à 1, donc positifs..
Donc vn+1-vn > 0 ; (vn) est croissante. Réponse A.
On considère deux évènements A et B, d’événements contraires non A et non B tels que P
non B (non A)
= 0,2
et P(A) = P (non B)
= 0,6.
Alors la probabilité P (non
A ∩B )
est égale à :
Formule des probabilités totales :
P(non A n B) + P(non A n non B) = P(non A).
P(A) = 0,6 ; donc P(non A) = 1-0,6 = 0,4.
P(non A n non B) = P(non B) x P
non B (non A) = 0,6 x0,2 = 0,12.
Donc P(non A n B) +0,12=0,4.
P(non A n B )=0,4 -0,12 = 0,28. Réponse B.
QCM 12. L'intégrale suivante est égale à :
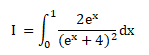
On pose u = (ex+4) ; u' = ex.
Primitive de u'(x) / u(x)2 = -1/u(x) = -1 /(ex+4).
I = 2[-1 /(ex+4)]01=-2/(e
1+4)+2/(e
0+4) = -2 /(e+4) +2 /5.
Réponse C.